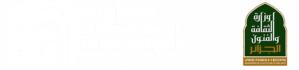Depuis que les frères Lumière ont offert à l’humanité cet extraordinaire levier narratif qu’est le cinéma, nous avons découvert une possibilité insoupçonnée : celle de rivaliser avec le rêve et, au bout du compte, de projeter sur un écran les scènes les plus marquantes de notre temps. C’est précisément ce qui m’est arrivé l’autre jour lorsque, apprenant la triste nouvelle du décès de l’actrice Biyouna, j’ai aussitôt rembobiné dans ma mémoire les images de la série culte L’Incendie. Un récit de vie d’une époque révolue, dans un pays lui aussi profondément transformé, raconté en douze épisodes filmés avec la même caméra que Rossellini et ciselés par les doigts de l’orfèvre Mohamed Dib. Le réalisateur y dépeint le quotidien d’une poignée de familles vivant en voisinage autour d’un patio mauresque, coincé entre une douzaine de colonnes comme on n’en fait plus. L’histoire se déroulait avant, puis pendant la guerre.
Je devais avoir l’âge du petit Omar lorsque j’ai regardé la série pour la première fois. J’avoue ne plus savoir si feu mon père avait acheté la télévision pour ne rien rater du fameux combat de Mohamed Ali chez Mobutu, ou simplement pour se régaler des dribbles de Johan Cruyff lors de la Coupe du monde 1974. Peut-être était-ce même deux ou trois ans plus tôt, au moment de la prise d’otages des Jeux de Munich par un commando du FPLP ; autrement, comment pourrais-je me souvenir avec autant de netteté de l’épilogue regrettable de cette opération ?
Pendant les quarante minutes que durait chaque épisode, Dar S’bitar ouvrait grand ses portes à toutes les familles. Le patio devenait l’école de la vie de tous les gamins du même âge qu’Omar, et les cuisines, celles des jeunes femmes qui imitaient le râle tendrement fourbe et amusée de Fatma (interprétée avec brio par Biyouna). La Grande Maison, c’était tout cela à la fois : un lieu où l’écho de la rue venait planner, invisible à l’image, un peu comme dans Une journée particulière d’Ettore Scola ; un endroit où circulaient les ragots et les petites intrigues de ce petit monde entre-soi… Et, mine de rien, tout cela faisait un joyeux bazar, l’autre nom de la vie en temps de petite disette.
Les notes de ce microcosme doivent résonner encore au fond de la mémoire des mômes de ma génération : « Yemma, la police… », le tac-tac de la machine à coudre à pédale, la toux forcée annonçant l’arrivée du vieil homme au couvre-chef… L’interminable attente devant les sanitaires, véritable moulin à vent des persiflages de quartier… Et puis, surtout, il y avait la peur. Celle qu’inspiraient les descentes nocturnes des paras, martelant de coups de crosse le heurtoir d’une porte arquée centenaire ; une porte comme on en voit plus. Et le réalisateur d’enfoncer le clou grâce à cette musique, à mi-chemin entre l’oraison funèbre et le psaume, qui venait voiler un générique tremblotant, presque artisanal.
Deux ans plus tard, lorsque je réussis mon examen de sixième, je reçus en cadeau le livre éponyme. Jusqu’alors, je ne faisais que feuilleter impatiemment les magazines à bulles, les revues féminines de ma mère ou les quatrièmes de couverture des romans de la Série noire de mon père. Ma première véritable expérience de lecture d’un roman fut donc celle de ce livre-là, que je me souviens avoir dévoré dans l’espoir d’y retrouver les images de la série. Et pourtant, ce fut un flop, pour ne pas dire un désastre… Je cherchais partout Fatma (Biyouna), avec sa tignasse raide et luisante sous un éclairage minimaliste, Omar, occupé à tout observer en silence, et tout ce petit monde rutilant, patient et passionnant… Rien de tout cela ! Je me revois refermer la dernière page de ce qui fut la première — et la plus amère — de mes expériences de lecture, sans avoir retrouvé la scène où Fatma (sa sœur ?) embrassait un gigot d’agneau en longeant les travées de la Grande Maison. Inquiète, ma mère courut m’acheter La Grande Maison, l’autre roman ayant servi de matière pour scénario ; rien n’y fit, rien ne parvint à me consoler. Je n’ai retrouvé l’œuvre de Dib que trente ans plus tard. Si je ne me trompe pas, c’était son dernier livre, dans lequel il pourfendait une Algérie en dérive que personne n’avait vu venir.
Biyouna s’en est allée quelques jours avant l’ouverture du Festival international du film d’Alger… Il m’est difficile de ne pas y voir un signe. Serait-ce une de ses malicieuses entourloupes pour que l’on se souvienne d’elle, chez elle à Alger ? Ou bien, au contraire, souhaitait-elle que nous tournions enfin la page, avec elle, que nous nous désengluions de ce passé en noir et blanc — presque rossellinien — pour avancer, autrement, vers la lumière des projecteurs modernes ?