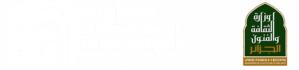« Houbla…Un billet de 200 dinars » de Lamine Ammar-Khodja a été projeté, lundi à la salle Ibn Zeydoun, dans le cadre de la compétition Longs Métrages de la 12e édition de l’AIFF. Cette projection n’avait rien d’un simple rendez-vous cinéphile mais plutôt l’ouverture d’une expérience sensorielle et mentale qui déborde de l’écran ;
Le film met en scène une artiste peintre dans un Alger calme presque silencieux, une ville à demi effacée, comme si elle retenait sa respiration. Dans ce décor suspendu, la silhouette d’un homme apparaît, un visage fugace que l’artiste décide de peindre mais dont elle ne parvient pas à retrouver les traits. Elle en garde une impression, une ombre, une trace impossible à reformer. Et, cette impossibilité devient le moteur du récit : elle marche, elle déambule, elle traverse des endroits connus et pourtant étrangers, comme dans un rêve dont elle ne voudrait pas se réveiller.
Expérimental à bien des égards, le film prend Alger, non comme un décor, mais comme une matière à éprouver. On explore certaines parties de la cité : le Jardin d’Essai, le parc de la liberté, l’espace Les Ateliers Sauvages, un appartement au centre-ville, une petite partie du boulevard Mohammed V ou la rue Didouche Mourad… Mais ce ne sont pas des cartes postales, aucun plan panoramique d’Alger, aucune ville fantasmée, seulement la perception du monde à travers le regard d’une artiste en train de créer. Et puis, cette volonté de refuser l’illustration du réel pour ne garder que l’intime donne au film une puissance singulière.
Le personnage de l’artiste, incarné par la peintre et autrice de bande dessinée Nawel Louerrad, semble perdue dans la ville et dans sa tête. Elle avance en cherchant quelque chose qui lui échappe. En effet, il lui manque la trace du visage qu’elle a vu, la substance, la consistance, le sens. Elle a besoin de connaître, de savoir, de comprendre, d’entendre et d’écouter. Elle veut briser le silence, ce silence intérieur et extérieur qui enveloppe Alger et son propre esprit. Le film fait naître une rencontre entre la créatrice et l’objet de sa création, une rencontre incertaine, fragile, hantée.
Les plans sont serrés, les histoires minuscules et autour, la vie continue, même si le temps se suspend pour l’artiste, fascinée par un détail, par un souffle, par un souvenir qu’elle n’arrive pas à organiser. Le récit se construit comme une dérive pas à pas. Le spectateur suit la quête d’un visage effacé, et découvre à travers elle la manière dont une œuvre se cherche, s’ébauche, se transforme.
Le rythme du film devient un éloge de la lenteur. Celle-ci n’est pas pose ou calcul, mais respiration et obstination. Le cinéma se fait attente, écoute d’un battement de cœur imperceptible. « Houbla » se présente ainsi comme une proposition radicale et douce, une promenade intérieure dans Alger, une quête sans résolution peut-être, mais avec une évidence : la beauté fragile de voir créer, et de voir chercher.