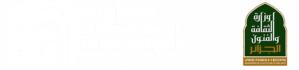Figure incontournable aux Pays-Bas, pionnier du théâtre et de la télévision pour enfants, Hakim Traïdia reste pourtant largement méconnu dans son pays natal. Présent au 12e AIFF, l’artiste algérien revient sur son parcours exceptionnel, sur la puissance créatrice de l’enfance qui le guide encore, et sur sa vision du cinéma en Algérie. Entre deux continents, Hakim continue de bâtir des ponts.
Comment un jeune Algérien peut-il débarquer dans un pays inconnu et devenir une célébrité ?
Ce qui m’a sauvé, c’est l’enfant que j’étais, celui qui ne m’a jamais quitté. Cette spontanéité, cette audace d’aller frapper aux portes sans savoir où cela mène… Je crois profondément que le voyage importe parfois plus que la destination.
Quand je suis arrivé aux Pays-Bas, je ne parlais pas un mot de la langue. J’ai donc commencé par faire du mime dans la rue. Et malgré la présence d’artistes du monde entier, même des Américains, je ne me suis jamais senti inférieur. Au contraire, c’étaient souvent eux qui me demandaient : « Tu trouves que je suis bon ? » Le public m’a suivi très vite. À l’époque, je pouvais gagner l’équivalent de 1000 euros par jour juste en jouant dans la rue. Les gens étaient touchés.
Et cette relation ne m’a jamais quitté : 35 ans de télévision pour enfants, cela marque des générations. Aujourd’hui, ceux qui ont 40 ou 45 ans reviennent me voir… avec leurs propres enfants.
Et pourtant votre œuvre reste toujours marquée par l’Algérie…
Oui, l’Algérie ne me quitte jamais. Mon village, mes souvenirs, mon enfance… Tout cela traverse mes histoires. Même lorsque j’invente, j’attribue souvent mes récits à mon père ou à mon oncle Ahmed, qui, en réalité, n’a jamais raconté toutes ces histoires que je lui prête !
Aujourd’hui, si vous tapez « Hakim Ahmed » sur Internet, tout le monde croit connaître mon oncle. Je l’ai transformé en mythe. C’est ça, le théâtre : un mélange fragile de vécu et de fiction.
Votre festival de cinéma est-il né de cette volonté de rencontrer d’autres cultures ?
Au début, c’était simplement l’amour du cinéma. J’ai grandi dans une salle obscure à Besbès : c’était notre fenêtre sur le monde. Quand j’ai eu une salle aux Pays-Bas, je me suis dit : Pourquoi ne pas faire venir des films africains, surtout maghrébins ? Sauf qu’en Hollande, le mot Maghreb n’existe même pas dans le dictionnaire. Alors nous avons élargi : du festival du cinéma maghrébin, nous sommes passés à un festival du cinéma africain. Et le public a répondu présent. Nous avons diffusé des films d’Afrique du Sud, du Sénégal, du Kenya…
Quelles sont les principales difficultés pour organiser un tel événement ?
Elles sont nombreuses : trouver des fonds, rédiger des dossiers, sélectionner des films, inviter les réalisateurs… Mais la vraie difficulté, c’est le manque de soutien institutionnel. Certains responsables assistent aux projections, mais ne nous aident ni financièrement ni en relayant l’information auprès de la communauté. Pour les visas, en revanche, je n’ai jamais eu de problème. Les ambassades me connaissent : nous avons fait venir 15 à 20 artistes sans difficulté. Ce qui manque, souvent, c’est le suivi. On écrit, on relance… et rien ne se passe.
Comment percevez-vous l’évolution récente des festivals en Algérie ?
Je sens une énergie nouvelle, très positive. Oui, il y a des critiques, et tant mieux ! Les critiques constructives font avancer. J’ai beaucoup aimé le festival de Timimoun, et celui-ci aussi. J’y ai senti une sincérité, une vraie volonté de valoriser le cinéma algérien. Des amoureux du cinéma au management. Bien sûr qu’il reste beaucoup de choses à faire, mais on apprend en organisant. Chaque édition sera meilleure que la précédente.
Et puis, il y a une vraie génération qui monte : Yanis Koussim, Anis Djaad, Omar Belkacemi, les jeunes comme Youssef Mahssas… On sent une renaissance.
Être une star aux Pays-Bas mais peu connu en Algérie, est-ce un handicap ?
C’est certain que si j’avais le même statut en France, je serais connu dans toute la francophonie. La langue limite beaucoup. Donc oui : il faut que je fasse l’effort de venir ici. Sinon, personne ne saura que j’existe. Mais je ne viens pas pour me faire connaître : je viens pour partager. Pour transmettre ce que j’ai appris.
Vous avez tenté de créer une école de cinéma pour enfants en Algérie. Où en est ce projet ?
Aux Pays-Bas, j’ai une école depuis huit ou neuf ans. Les enfants y apprennent à écrire, filmer, monter, jouer… C’est magnifique de les voir grandir à travers la création.
En Algérie, un responsable culturel voulait que je crée la même structure. Le projet a traîné cinq ans… pour ne jamais aboutir.
Ce n’était pas un problème d’argent : je ne fais pas ça pour vivre, je gagne ma vie ailleurs. Je voulais offrir quelque chose aux enfants d’ici. Malheureusement, une seule personne peut bloquer un projet. Et c’est ce qui s’est passé.
Que faudrait-il pour relancer durablement le cinéma en Algérie ?
Oui, il faut rouvrir des salles. Mais surtout, il faut les confier à des passionnés. Pas à des institutions qui s’en moquent. Il faut des gens qui aiment le cinéma comme on aime un enfant : avec patience, dévotion et vision. Et puis, il faut investir dans les jeunes. Créer des sections jeunesse dans les festivals. J’ai fait cet exercice avec des enfants à Timimoun. Et pourquoi pas créer un festival du film pour enfants. Leur offrir un espace de créativité. Parce que l’avenir du cinéma algérien renaîtra à travers eux.