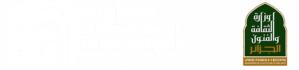Rencontré à l’issue de la projection de son long-métrage de fiction « Après la fin », le
cinéaste argentin Pablo César revient dans cet entretien sur la genèse de son projet. Ayant
déjà réalisé plusieurs coproductions avec des pays africains, il évoque son idée de faire un
film sur la ville d’Oran, qui entretient un lien historique avec une ville éponyme en
Argentine.
Qu’est-ce qui a été le point de départ du film « Après la fin » ?
J’ai connu l’actrice pendant la pandémie de la Covid-19. Nous n’avons pas pu nous
rencontrer physiquement et j’ai entendu un enregistrement des poèmes qu’elle déclamait ; ils
m’ont beaucoup touché. Je l’ai contactée et elle m’a dit être trop âgée pour entreprendre une
carrière au cinéma. Elle n’avait jamais joué de rôle, et elle a fait son premier film avec moi à
l’âge de 88 ans. C’est peut-être une première dans l’histoire d’un long-métrage de fiction.
Vous songez à faire un film sur la ville d’Oran, qui semble avoir un lien avec une ville
portant le même nom en Argentine. Parlez-nous-en..
En effet, je pense à écrire un film sur la ville d’Oran, car il existe en Argentine, dans la
province de Salta, une ville qui porte le même nom, avec un léger accent sur le « a », mais
qui se prononce de la même manière. Il y a une grande histoire concernant des musulmans
qui ont habité cette ville, dont des pieds noirs. J’ai lu beaucoup d’histoires sur la ville d’Oran
en Algérie, et j’ai un ami qui y est né. Je pense à la possibilité d’en faire un film pour
montrer les deux Oran dans une fiction, afin de créer un pont culturel entre les deux pays.
Quelle a été la plus grande difficulté artistique lors de la réalisation du film ?
Il fallait trouver des actrices pour jouer les rôles à 10 ans, 16 ans et 40 ans. Trois actrices
différentes devant avoir des traits de ressemblance, bien entendu, avec un énorme travail de
direction pour les jeunes actrices, afin qu’elles s’approprient le caractère du personnage.
Quels défis rencontrez-vous pour financer et diffuser un cinéma indépendant et
poétique dans le paysage mondial actuel ?
En Argentine, le cinéma traverse une période très difficile, car le pays a perdu beaucoup
d’opportunités à cause de la dévaluation de la monnaie. Les subventions que l’État octroyait
à la production cinématographique ont nettement diminué durant la dernière décennie.
Vous avez réalisé 18 longs-métrages, dont la moitié en coproduction avec des pays
africains. Qu’est-ce qui rend ces collaborations essentielles pour vous ?
J’ai fait beaucoup de coproductions avec des pays africains, car je me sens africain. Je
présente au 12e AIFF, dans le cadre du panorama Sud-Sud, un documentaire intitulé
Maconge, la Córdoba africaine, en référence à la ville de Córdoba en Argentine, où
subsistent des traces de la population noire africaine qui fut réduite en esclavage durant la
période coloniale. Je cherche des liens entre l’Argentine et l’Afrique à travers les traces de
notre société.
Tout le monde croit que l’Argentine n’a aucune relation avec l’Afrique, alors qu’en
cherchant, on trouve beaucoup d'éléments. À titre d’exemple, ce sont des artistes africains de
Montevideo et Buenos Aires qui ont contribué à créer la musique et la danse du tango. J’ai
commencé à coproduire avec la Tunisie en 1990, puis avec le Cap-Vert, la Namibie et bien
d'autres pays.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans la mise en place de coproductions Sud-Sud et
comment parvenez-vous à les surmonter ?
La coproduction est de plus en plus difficile à cause de la situation économique de
l’Argentine. Pourtant, elle demeure une grande solution pour le cinéma indépendant. Tout
dépend du choix du producteur et de son engagement à porter un film. Il faut aussi savoir
que la plupart des coproductions cinématographiques africaines se font avec des pays
européens, notamment la France, et très peu avec l’Amérique latine. Pourtant, les liens entre
nos continents sont incroyablement nombreux et nous avons beaucoup d’histoires similaires.
Que connaissez-vous de la culture algérienne et de son cinéma ?
L’Algérie occupe une place très importante dans l’imaginaire africain, d’abord pour sa
glorieuse Révolution et sa liberté arrachée haut la main. Le film La bataille d’Alger (1966) a
fait connaître l’Algérie dans le monde entier et lui a donné une place de premier rang dans le
cinéma africain.
Vous enseignez à l’Université du cinéma de Buenos Aires depuis 1992. En quoi votre
expérience africaine influence-t-elle votre pédagogie ?
Mon expérience en Afrique a beaucoup influencé mon parcours pédagogique. La magie du
continent et ses paysages naturels féeriques m’ont profondément marqué. Sa richesse
historique et sociologique m’a fait redécouvrir le cinéma d’auteur, la culture orale, l’héritage
millénaire et la grande sagesse présente dans les quatre coins du continent.