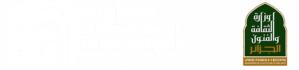Depuis sa naissance, au même titre que la peinture avec la question de la perspective, le cinéma n’a cessé de se confronter à la question de la représentation de l’espace. Avec l’invention de l’image animée, l’art cinématographique a très vite été obligé d’inventer différentes approches esthétiques pour représenter des lieux, des territoires et des modes d’occupations spatiales. Ce faisant, il ne pouvait ignorer ce que ce formidable pouvoir de création pouvait impliquer en termes de mise en scène d’un certain ordre social et économique. Pour le dire autrement, qu’il en assume ou pas les enjeux, à travers ses multiples lectures/interprétations de l’espace, le cinéma est partie prenante des processus idéologiques par lesquels sont produits, se diffusent et s’affrontent les discours de légitimation et de délégitimation des rapports sociaux et des mécanismes de domination. A titre d’exemples, on peut citer les différentes mises en scène de la banlieue (de la médina en contexte colonial) pour ce qui relève de la ville, ou plus généralement de l’espace urbain dans sa relation avec l’espace paysan/montagnard. On peut aussi mentionner l’univers du western américain et son traitement thématique de la frontière. En tout état de cause, quel que soit le cadre (citadin ou rural, local ou exotique), il est ici question des différentes manières de l’habiter et donc des « tactiques » et des « stratégies » (De Certeau) mobilisées par les « usagers » et les acteurs politiques pour défendre leurs intérêts respectifs. D’un point de vue historique, dans le contexte de la formidable dynamique socioéconomique, scientifique et culturelle de l’Occident capitaliste, le cinéma s’est très rapidement retrouvé impliqué dans les grandes manœuvres impérialistes. Et donc partie prenante dans les processus militaro-industriels de domination des espaces coloniaux. Si, pour reprendre la célèbre formule d’Yves Lacoste, « la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre », il est certain que le cinéma a, lui aussi, contribué à configurer les imaginaires territoriaux en lien avec l’aventure impérialiste occidentale en Afrique, en Asie et en Amérique. Il n’est, pour s’en convaincre que de se rappeler les premières images tournées en Algérie pour les frères Lumières par l’opérateur Alexandre Promio en 1896. La volonté de mettre en scène l’appropriation de l’espace « indigène » et sa reconversion en une colonie moderne et prospère s’affiche de façon on ne peut plus explicite. Plus tard, dans les années 1930-40, des productions telles que Pépé le Moko ou L’Atlantide révèlent clairement la manière dont le cinéma colonial, dans la logique de l’esthétique orientaliste, a réussi à créer un dispositif sémiologique relativement élaboré pour circonscrire et hiérarchiser les espaces « autochtones » (médina ou désert) afin de les « assimiler » sur le plan folklorique et de réduire ainsi les communautés « indigènes » au statut de figurants à la présence fantomatique – et pourtant gênante. En réalité, comme le dit Fanon : « Le monde colonisé est un monde coupé en deux. La ligne de partage, la frontière en est indiquée par les casernes et les postes de police. » (DT) C’est cette « ligne de partage » que la guerre de libération va faire précisément voler en éclat en remettant en cause les rapports de domination et en répondant à la violence coloniale par la contre-violence révolutionnaire. Ce sera l’occasion pour le cinéma algérien naissant de se réapproprier les espaces et les lieux de l’identité nationale (la Casbah, le maquis) et de mettre en scène ses nouvelles figures emblématiques (le maquisard, le martyr). Comment ne pas penser ici aux documentaires de René Vautier (L’Algérie en flamme) et des premiers cinéastes militants de la cause nationale. Dans la période post-indépendance, à travers un certain nombre de grandes productions ou de feuilletons télévisés : Le Vent des Aurès, La Bataille d’Alger, Hassan Terro, El-Hariq) le cinéma algérien – entièrement financé et géré par des organismes étatiques – contribuera puissamment à entretenir et à enrichir le récit national. L’enjeux étant de réussir à articuler des espaces historiques et politiques dont la symbolique pouvait prêter à des interprétations contradictoires. Exemples avec la campagne (défini comme le berceau originel de la Révolution et sa composante première et « authentique » : la paysannerie) et la ville (conçue comme le lieu alternatif de la résistance, avec son lumpenprolétariat et ses vieilles traditions urbaines). Dans les années 1970, en initiant ce que la critique désignera sous le nom de « cinéma ElDjadid », une « nouvelle vague » de cinéastes tentent de repenser le rapport à l’espace national et donc à l’identité nationale à la lumière des nouveaux enjeux socio-économiques et culturels post-indépendance. C’est l’heure des questionnements, des interrogations, voire des désillusions. En réinvestissant de manière critique, voire polémique, l’espace urbain et ses frontières (sociales, culturelles, administratives, politiques), Le Charbonnier ou Omar Gatlato témoignent à la fois des contradictions idéologiques et des attentes des nouvelles générations. A l’inverse, en imaginant pour ses héros une topographie « nomade », inscrite dans une réalité à la fois fantasmatique mais mobilisant un véritable « cocktail » de références identitaires proprement algériennes, Le Clandestin (Benaamar Bakhti) préfigure d’une certaine manière les désarrois socioculturels de la génération des jeunes migrants clandestins (harragas). Plus tard, avec la « décennie noire » et ses conséquences, les cinéastes se retrouvent confrontés à la nécessité de rendre compte d’un nouveau rapport à la géographie. Celle de leur pays en proie à une violence qui redéfinit les territoires en fonction de l’évolution des rapports de force entre protagonistes de la tragédie nationale et projette aussi les imaginaires vers des horizons marqués par de nouvelles trajectoires exiliques.
Mourad Yelles Inalco – Lacnad (Paris)